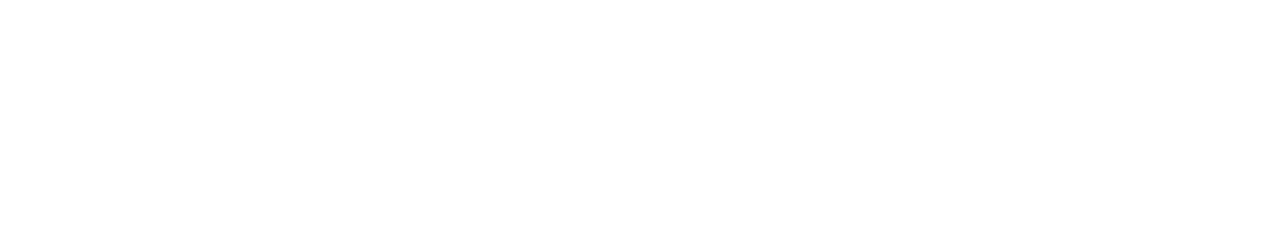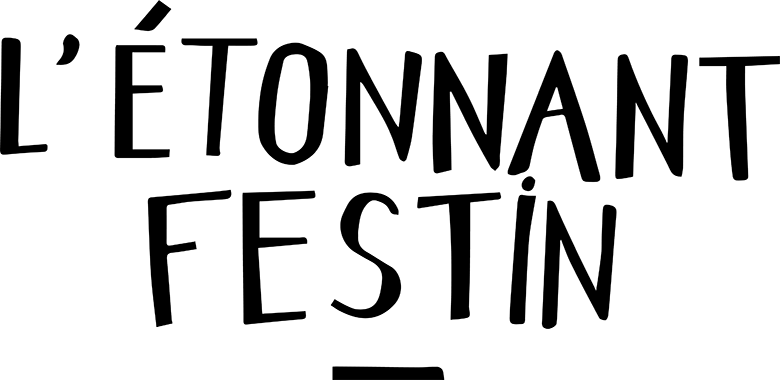Les Jardins Vivriers
Le jardin est tout à la fois un espace de production alimentaire et de sociabilité. Il peut être de nature différente, loisir et lieu de détente, mais aussi espace de travail en plus, en dehors du travail salarié. Il est un lieu de rapport, économique, en donnant à manger mais aussi social, permettant la circulation des savoirs, des connaissances et des relations sociales et culturelles.
Les jardiniers organisent et font vivre le jardin, en lui donnant la forme de leur désirs et de leurs envies de productions alimentaires, de leurs origines culturelles et de leur histoire. C’est aussi un espace d’expérimentation et de prospection de ce qu’est le fait de produire son alimentation, et de l’inscrire dans un temps long, au moins une année, au moins une saison.
Jardiner c’est se confronter au cycle complet de ce que produire sa nourriture veut dire, de la semence à la transformation, voire à la conservation alimentaire. En cela, jardiner c’est expérimenter, c’est accumuler par l’expérience de la pratique, des savoirs et des connaissances, c’est apprendre et/ou transmettre par observation, recherche académique mais aussi imprégnation orale et gestuelle.
Pour cela, les jardins, sous toutes leurs formes (familiaux, ruraux, partagés, ferme urbaine), offrent de nombreux champs de réflexions sur comment évolue et se construit notre relation et nos représentations de la production, de la mise en réserve, de la transformation et de la consommation de nos aliments.
Tout à la fois espace de conservation mais aussi d’imagination pour faire face aux nombreuses questions et tensions que soulèvent :
- les sols, leur entretien et leur amendement,
- les semences, leurs origines, leur multiplication et leur diffusion,
- les procédés culturaux, la lutte ou l’adaptabilité aux (ou contre) maladies et insectes,
- la gestion de l’eau, son manque, son économie,
- les notions de propriété, d’accès à la location, d’intrusion mais aussi de la perméabilité du jardin, tout à la fois espace aux vues de l’autre et de forte intimité.
A Clermont-Ferrand, sur le territoire de la métropole et de manière plus large sur le bassin de vie Clermontois, les jardins dits “familiaux”, anciennement ouvriers, donnent à observer une vitalité toute particulière à ce territoire.
Faits par des personnes aux revenus modestes, originaires du monde entier, venus ici pour travailler, les jardins donnent à voir le souvenir du pays ou de la région d’origine. Ils sont l’ailleurs reconstruit ici. Inconsciemment, les jardiniers-voyageurs naturalisent leurs goûts de légumes et de fruits dans leur nouveau chez-eux. Un légume rapporté du Portugal ou du Laos se fait, s’adapte, se loge, de semences en récoltes, à son nouvel environnement. Il se naturalise, enrichissant les choix et les cultures. Choux et tomates portugais, poivrons des Balkans, tomates du Maghreb, navet verdure de Galice, baselle et ail vert du Laos, piments, deviennent auvergnats.
Le jardin par ailleurs si intime, déborde toujours. Il déborde avec les semences qui sont données aux voisins. Mais surtout, il prend la poudre d’escampette, parce qu’à Clermont les particuliers-jardiniers peuvent demander l’autorisation de vendre sur les marchés. Ils sont marchands au panier, vendant le surplus de leur production, et leurs légumes peuvent être achetés par tous et chacun pour basculer dans la marmite commune des Clermontois.
Réfléchir, observer les jardins, rencontrer, échanger ou réunir les jardiniers construit un paysage sensible d’une part de nos choix alimentaires. Valoriser les savoirs, les gestes que les jardins imposent, tissent le canevas d’une science populaire, pour satisfaire nos désirs d’esthétiques, de produire, de donner, d’imaginer.